Quatre questions à Michel Biron
–

Michel Biron
Professeur de littérature québécoise à l’Université McGill, Michel Biron a publié en 2000 L’Absence du maître, Saint-Denys Garneau, Ferron, Ducharme (prix Jean Éthier-Blais). Il est aussi le coauteur d’une magistrale Histoire de la littérature québécoise (Boréal, 2007; prix Gabrielle Roy et prix Jean Éthier-Blais). Son essai La Conscience du désert vient de paraître au Boréal, et nous l’avons questionné à ce sujet…
–
Qu’avez-vous cherché à faire, dans cet ouvrage?
En gros, j’ai voulu réfléchir au monde dans lequel je vis en m’appuyant non pas d’abord sur des faits historiques, des données sociologiques ou des réalités anthropologiques, mais sur des textes littéraires. À travers des œuvres d’auteurs anciens ou contemporains, québécois ou étrangers, j’essaie de voir ce qui change dans mon monde, mais aussi ce qui me rattache au passé et ce qui me rapproche de ce qui s’écrit ailleurs. De tels textes me permettent aussi d’observer ce que devient la littérature dans un monde comme le nôtre. À vrai dire, mon interrogation est double: en premier lieu, je me demande ce qu’est la littérature dans une société comme la québécoise, où la tradition d’écriture demeure fragile, où les textes les plus forts sont ceux qui assument la fragilité même de cette tradition; en second lieu, je pose aussi la question de façon beaucoup plus générale, car la désintégration relative de la littérature à laquelle on assiste depuis environ 1970-1980 dépasse, de loin, le seul cas du Québec.
–
Qu’est-ce que cette «conscience du désert» qui marque selon vous la littérature québécoise?
Toute la littérature québécoise est peuplée de personnages qui s’évadent vers le désert qu’est le Nord. L’exemple pour moi le plus éclairant est celui du père de Maria Chapdelaine qui ne peut supporter le fait d’avoir des voisins et «mouve» toujours plus au Nord, là où il n’y a encore personne, là où l’individu est soi-disant libre, dégagé de toute tradition contraignante, mais exposé aux vertiges mêmes que cette liberté entraîne. Du «monde irrémédiable désert» de Saint-Denys Garneau aux «mondes peu habités» de Pierre Nepveu, il y a là une constante qui me paraît tout à fait significative. On peut certes l’interpréter de façon négative en parlant du Québec comme d’un «désert culturel», et il n’est pas rare de trouver des remarques en ce sens chez les écrivains comme chez les critiques. Il est encore moins rare de trouver des commentateurs enthousiastes qui défendent la thèse inverse avec un optimisme aussi sympathique que suspect. Or, de mon point de vue, le mot-clef dans l’expression «conscience du désert» est le mot «conscience». Il suppose une lucidité et une force qui sont à la base de l’écriture. Plusieurs auteurs (parmi les meilleurs), loin de chercher naïvement à vouloir prouver que le «désert» n’en est pas un, font de la «conscience du désert» le moteur de leur écriture et le lieu par excellence de leur imaginaire. Ce sont ces écrivains qui sont analysés dans mon ouvrage.
–
Vous faites référence au modèle belge, qui pourrait inspirer le rapport québécois à la littérature. Dans quel sens?
La Belgique, pour moi, est une sorte d’antidote idéal à la «surdose nationaliste» propre à la littérature québécoise. Quand je parle à mes amis belges, l’idée même d’une littérature «nationale», «régionale» ou «locale» les fait sourire. Il y a, oui, des écrivains belges, comme Simenon et Henri Michaux, mais leur identité nationale (ou régionale) importe assez peu. Ce sont des écrivains. De nombreux critiques ont montré qu’il y a, malgré tout, une «belgitude» qui peut se lire à même ce refus de l’identité nationale (ou régionale), mais cela ne change rien au fait que ces écrivains appartiennent d’abord à la littérature. Une telle phrase, j’en conviens, était naguère le comble du conformisme universalisant et sentait la poussière de l’humanisme. Aujourd’hui, il me semble qu’elle a quelque chose de scandaleux et de nécessaire. D’où l’idée du «modèle belge», étant entendu qu’une telle expression est une forme de contradiction dans les termes.
–
Parlez-moi un peu de ce que vous qualifiez de cassure dans le lien entre les écrivains québécois et la littérature française?
C’est un constat assez simple: l’écrivain québécois de 1960 ou de 1970 a été formé à la littérature à partir des modèles classiques français; l’écrivain québécois de 1990, lui, a grandi en ayant des modèles littéraires québécois. Les classiques français lui sont encore familiers, mais dilués dans un ensemble hétérogène et sans constituer sa véritable tradition: c’est une tradition parmi d’autres. Entre des écrivains d’hier comme Ducharme ou Aquin et des écrivains d’aujourd’hui comme Louis Hamelin ou Nicolas Dickner, la cassure est radicale, d’autant plus radicale qu’elle n’a pas fait l’objet d’une revendication particulière, qu’elle s’est imposée d’elle-même. Il me semble qu’on n’a pas encore pris la mesure de cette cassure.
***
Pour feuilleter le livre, cliquer ici.
Tous les détails sur le livre sont ici.
Tél: (514) 287-7401 Téléc: (514) 287-7664
Les photos des auteurs ne peuvent être reproduites sans l'autorisation des Éditions du Boréal.


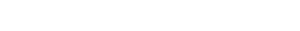

Aucun commentaire