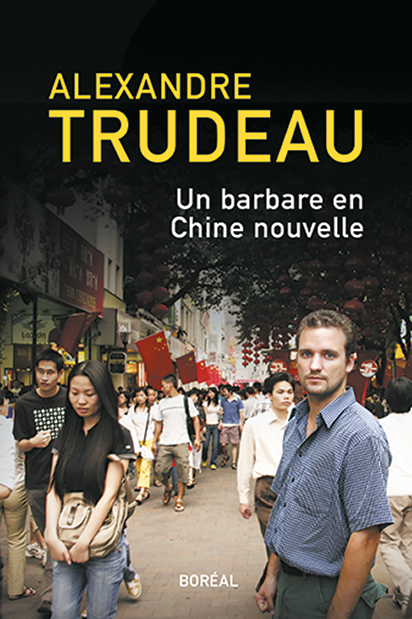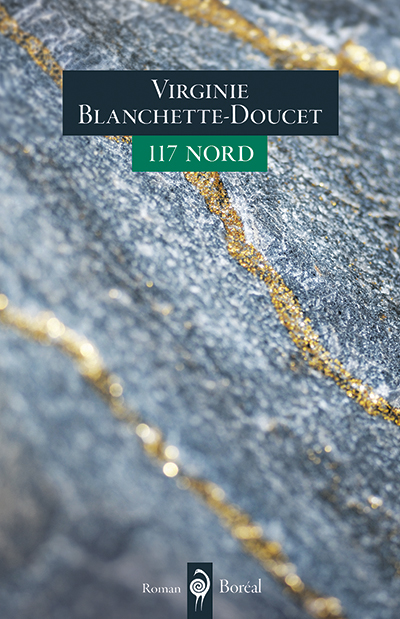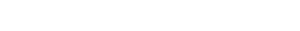Archive pour la catégorie « entretien »
Entretien avec LOUIS HAMELIN
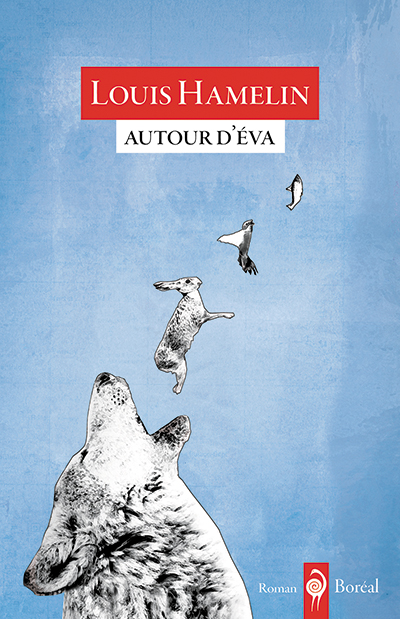 Depuis La Constellation du Lynx, on sent chez vous une fascination pour la politique, surtout sa face sombre. Qu’est-ce que le roman peut apporter à la politique, et la politique au roman?
Depuis La Constellation du Lynx, on sent chez vous une fascination pour la politique, surtout sa face sombre. Qu’est-ce que le roman peut apporter à la politique, et la politique au roman?
Le roman pourrait apporter quelque chose à la politique si les politiciens lisaient des romans. Dans un monde idéal, le roman pourrait même contribuer à former de meilleurs électeurs, en ouvrant l’imagination, en élargissant le spectre des possibles. Mais depuis que le roman a pratiquement disparu de la place publique (ce n’est pas de lui qu’on discute autour de la machine à café, en tout cas, ni même dans un souper entre amis intellos, où ce sont les séries télé américaines pigées sur Netflix qui monopolisent maintenant la conversation), depuis, donc, que le roman a quitté la place publique (mais l’a-t-il vraiment déjà occupée ?), son rôle comme « influenceur d’opinions » est forcément très réduit.
La politique, par contre, peut apporter beaucoup au roman. Le pouvoir est une machine à fabriquer des histoires, comme Shakespeare l’avait bien compris. Je suis toujours surpris de constater à quel point les Québécois sont frileux sur ce plan. Quel romancier a osé aller renifler du côté du Bunker ? L’ironie romanesque se prête merveilleusement bien à la description de l’univers politique. Or, la politique est un monde bridé, aux antipodes de la liberté du littérateur. C’est un peu déprimant. Un René Lévesque n’est plus possible aujourd’hui. Le romancier peut au moins se consoler en le ressuscitant dans ses livres…
L’Abitibi et sa nature jouent un très grand rôle dans ce roman. Qu’y voyez-vous de si particulier?
Ça aurait aussi bien pu être le Saguenay ou la Côte-Nord. Il se trouve que j’ai passé quelques années de ma vie d’écrivain dans la forêt abitibienne, et mon univers romanesque en a été comme tout naturellement imprégné. Mais, en fait, le conflit qui est au centre de Autour d’Éva m’a été inspiré par un projet de développement qui visait un lac de la Mauricie. J’ai pris le superhôtel de M. Sylvain Vaugeois (un ami de Bernard Landry et du sérail péquiste, en passant…) et je l’ai déplacé en Abitibi ! Cela dit, je suis un amant fou de la forêt, et en Abitibi, il n’y a pas de montagnes, pas de mer ou de fleuve pour faire diversion : on est devant la forêt jusqu’à l’horizon. Et c’est encore mieux quand elle n’est pas défigurée par les coupes à blanc et les puits de mine…
Vous exprimez un scepticisme certain devant l’action écologique et sociale. Croyez-vous qu’il s’agit là d’un combat dépassé?
Dépassée, l’action écologique et sociale ? Jamais de la vie ! Est-ce que le débat sur l’extraction pétrolière et les pipelines est dépassé ? Au contraire, l’action environnementaliste et citoyenne est plus que jamais au centre de l’actualité. Développeurs contre défenseurs de l’environnement : du marais de la rainette jusqu’au macrocosme climatique, c’est le schéma de base des trois quarts des affrontements politiques qui font les manchettes. Dans ma vie personnelle, je suis un farouche partisan de la préservation intégrale du plus grand nombre de milieux vivants et de forêts vierges possible. Je ne suis pas « sceptique » par rapport à la pertinence du combat pour la survie du monde sauvage. Juste un peu découragé, des fois, tellement la ligne de front est étendue. Découragé devant le nombre de feux à éteindre… et sans cesse rallumés, parce que l’humanité, quand elle ne donne pas l’impression de régresser, évolue, au mieux, à pas de tortue.
Dans mon roman, il y a une double réflexion qui s’articule autour, d’une part, de la question de l’engagement social et environnemental des artistes connus, et d’autre part, des effets néfastes d’un power trip dans n’importe quel contexte politique. Mais la réflexion ne prend jamais le pas sur la fiction. C’est l’histoire d’Éva que je raconte. Et j’ai voulu avant tout écrire une bonne histoire.
Votre roman est tout sauf politically correct. Vous prenez une grande liberté à montrer les paradoxes, souligner les aspects peu reluisants de certaines icônes, de certains personnages publics québécois. Craignez-vous les réactions du public?
À part René Lévesque et le docteur Laurin, qui sont des monuments, plus un petit coup de griffe à Lucien Bouchard et des clins d’œil sympathiques à une couple de journalistes, je n’identifie, dans Autour d’Éva, aucun « personnage public québécois ». Les gens seront peut-être tentés de rapprocher Dan Dubois de Jean-Claude Lauzon, de Roy Dupuis ou de Richard Desjardins, mais c’est leur problème. La vérité, c’est que Dan Dubois, comme Chevalier Branlequeue dans La Constellation, est une pure fabrication et une créature aussi composite que le monstre de Frankenstein.
Croyez-vous que le Québec soit devenu « sage », incapable d’autocritique? Sommes-nous devenus frileux?
Le Québec n’est pas sage, il est satisfait. C’est bien pire. Pour ce qui est de la frilosité et de la critique, on devrait se chicaner un peu plus souvent. Ça nous ferait du bien.
Quel rôle la littérature joue, peut ou doit jouer dans notre société ?
Le seul rôle de la littérature, c’est d’être une école de liberté. Toute autre mission qu’on pourrait vouloir lui confier est réductrice et la rend beaucoup moins intéressante.
Enregistrer
Entretien avec RENAUD JEAN
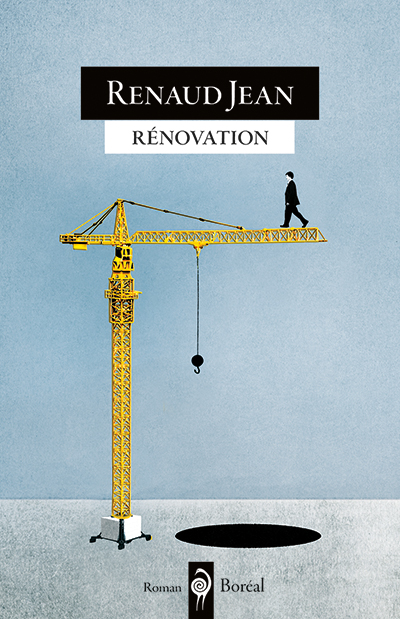 L’image du parc d’attractions, déjà présente dans Retraite, se trouve au cœur de votre roman. Pourquoi est-elle si importante pour vous ?
L’image du parc d’attractions, déjà présente dans Retraite, se trouve au cœur de votre roman. Pourquoi est-elle si importante pour vous ?
Ce qui s’exprime à travers le parc de loisirs, c’est une idée du monde à laquelle le narrateur a du mal à adhérer : il est le symbole d’une agitation insolite. Gigantesque et infiniment varié, en perpétuelle expansion, le Parc suppose qu’on cherche à lutter contre un ennui extraordinaire… Son existence est source de perplexité pour le narrateur, mais elle est aussi à l’origine de réflexions sur la nature inconnaissable du monde, son immensité et la métamorphose dont il est continûment l’objet. L’image du Parc conjugue, en outre, dans mon roman, les deux pôles du travail et du loisir, puisque ce Parc nous est présenté à travers le regard d’un employé (un employé dont la place est d’ailleurs, en quelque sorte, intermédiaire, entre celle de ses collègues et celle des visiteurs, dans les hauteurs d’un Monorail qui fait le tour du lieu).
Votre héros entretient une relation frustrante avec le monde du travail ; toutefois, ce n’est que dans celui-ci que nous le voyons exister. Pourquoi ?
Il me semble que nous nous définissons – ou que nous sommes définis – surtout par la place que nous occupons dans le monde du travail. Dès l’adolescence, nous sommes invités à songer à une carrière : notre formation doit mener à l’exercice d’un métier ou d’une profession. On attend de chacun qu’il travaille, et ceux qui ne travaillent pas sont considérés avec suspicion. L’homme a peut-être besoin du travail, mais le travail, souvent, dans notre société, est coupé de son sens – le sens qu’il devrait avoir, un sens plus « organique » – et rend malheureux. Tout se passe comme si nous n’étions que les rouages de la grande machine du capital, dont la primauté sur les autres sphères de l’existence serait incontestable. Ces réflexions ont dû jouer plus que je ne l’imaginais dans l’élaboration de mon roman.
Vous décrivez un monde qui enferme l’individu dans des logiques absurdes, souvent incompréhensibles. Croyez-vous que votre personnage ait une part de responsabilité, voire de liberté, quant à son avenir ?
Oui, dans une certaine mesure. Et cela lui est même rappelé à quelques occasions (mais on pourrait penser aussi qu’on se moque de lui). Cependant, il y a chez ce personnage une certaine passivité, proche de la docilité, qui fait qu’il se plie aux circonstances. S’il esquisse parfois un mouvement de révolte, il accepte généralement son sort. En même temps, le monde où il évolue est tellement imprévisible qu’il est difficile pour lui de savoir ce qu’il peut vraiment faire. Et quant à savoir ce qu’il veut, c’est un autre dilemme : on est censé avoir des champs d’intérêt, des aptitudes, des ambitions, mais le narrateur se sent étranger à tout ça.
La psychologie est absente de votre roman. Est-ce un choix délibéré ? Quelle en est la raison ?
La littérature se passe dans le non-dit. Il ne faut pas tout expliquer. Je préfère les livres qui me laissent deviner les mouvements intérieurs des personnages par leurs actions, leurs comportements. J’ai voulu écrire quelque chose qui soit à la fois énigmatique et transparent, sans recourir à quelque déterminisme que ce soit, sans essayer de tout justifier. La vie telle que l’éprouve le narrateur est une dérive mystérieuse, déconcertante : il suffit de montrer cette dérive pour exprimer le désarroi du personnage. Cette façon de faire permet aussi, me semble-t-il, d’engendrer beaucoup d’humour.
Cela dit, il ne faudrait pas croire que je me suis interdit formellement toute psychologie (il y en a peut-être quelques touches ici et là) : l’écriture est pour moi affaire de sensibilité, et j’essaie seulement d’être fidèle à mon intuition au moment d’écrire. Il y a un danger à trop intellectualiser la chose, car on risque alors de verser dans le programme.
Y a-t-il des auteurs qui vous ont inspiré ou habité en écrivant ce livre ?
À la fin de l’adolescence, La Salle de bain de Jean-Philippe Toussaint m’a ouvert un monde, et l’influence de ce livre a certainement agi dans l’écriture de Rénovation, du moins dans l’amorce. J’ai découvert ensuite d’autres écrivains contemporains dont la manière m’a fortement marqué (notamment en ce qui concerne l’humour) : Christian Oster, Lydie Salvayre, Éric Chevillard, Benoît Duteurtre et Antoine Volodine pour n’en nommer que quelques-uns. L’œuvre d’Albert Cossery m’a beaucoup touché aussi en ce qui concerne le sujet du travail. Cependant, celui qui ne cesse de m’accompagner est sans conteste Emmanuel Bove, dont le roman Mes amis (un peu à l’instar de Confession de minuit de Georges Duhamel et plus généralement de tout le cycle Vie et aventures de Salavin) a laissé en moi une empreinte durable. Bove dit la détresse morale de ses personnages comme nul autre, avec une vérité et une émotion sans pareilles.
Quel rôle la littérature joue, peut ou doit jouer dans notre société ?
Il y a une citation du poète William Cliff que j’aime beaucoup : « Pour moi, c’est ça la littérature : dire ce qu’on ne dit pas de vive voix dans la société, et qu’on écrit en cachette. »
La littérature est un ressaisissement, elle donne de la vigueur en faisant renaître en nous le sentiment de l’existence. Elle permet d’exprimer l’ambiguïté de la vie, l’incertitude, le désarroi, la peur… Elle ramène le lecteur à sa solitude essentielle.
Cela dit, la littérature n’a pas de rôle à jouer. Elle ne sert à rien, elle ne doit servir à rien. Elle est inutile… et c’est ce qui fait précisément sa valeur.
Enregistrer
Entretien avec SIMON ROY
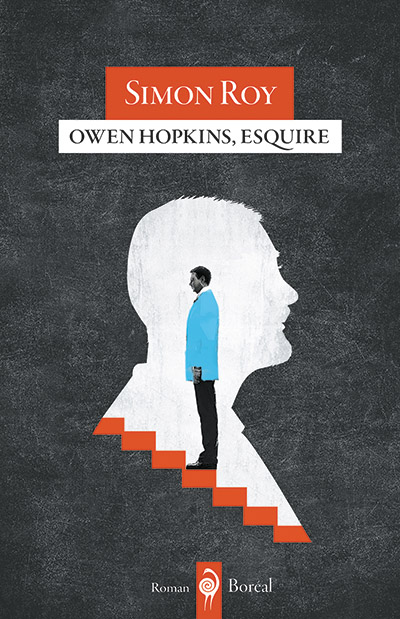 Le suicide de votre mère a réorienté radicalement votre projet d’ouvrage, qui portait à l’origine sur le film The Shining. Il n’est pas faux de dire que la mort de votre mère a servi de catalyseur pour l’écriture de Ma vie rouge Kubrick. En ce qui concerne le roman Owen Hopkins, Esquire, comment se sont dessinés les premiers contours de ce projet? Cela est-il parti d’une lecture significative, d’une idée quelconque qui a fini par devenir une obsession, d’un film, comme ce fut le cas avec l’œuvre culte de Kubrick?
Le suicide de votre mère a réorienté radicalement votre projet d’ouvrage, qui portait à l’origine sur le film The Shining. Il n’est pas faux de dire que la mort de votre mère a servi de catalyseur pour l’écriture de Ma vie rouge Kubrick. En ce qui concerne le roman Owen Hopkins, Esquire, comment se sont dessinés les premiers contours de ce projet? Cela est-il parti d’une lecture significative, d’une idée quelconque qui a fini par devenir une obsession, d’un film, comme ce fut le cas avec l’œuvre culte de Kubrick?
Une rencontre survenue il y a deux ans a sûrement joué un rôle clé dans la genèse d’Owen Hopkins, Esquire. Alors que j’accompagnais mon fils au parc, je suis tombé par hasard sur la mère d’une petite fille qui a étudié cinq ans dans la même classe que mon garçon, Colin, à l’école primaire. Laïka, qu’elle s’appelait… Cette pauvre enfant est décédée d’une étrange forme de leucémie à l’âge de dix ans à peine. Mon fils et moi sommes allés vers la mère pour la saluer, lui dire notre tristesse par un sourire inversé, un regard plein d’empathie. Nous ne nous étions pas revus depuis les obsèques, trois ans plus tôt. Sur le coup, elle n’a pas eu l’air de nous reconnaître (à l’époque, elle ne m’avait parlé que quatre ou cinq fois, guère plus, et mon garçon avait bien changé depuis la quatrième année, lui qui était désormais en première année du secondaire). Devant son malaise apparent, nous avons fait quelques pas en retrait, prêts à quitter les lieux, quand tout à coup la mère de Laïka s’est écriée : « Colin! Tu es bien Colin? » et elle s’est précipitée dans ses bras, lui maintenant aussi grand qu’elle. Elle a aussitôt fondu en sanglots… La digue venait de céder. Tout ce passage noir de sa vie rejaillissait, le sentiment de perte intolérable reprenait le dessus et emportait cette femme dans un tourbillon d’émotions. Le deuil impossible à faire pour une mère…
Comme si la mère s’imaginait sa fille, plus vieille, à travers un enfant de son âge que la petite avait côtoyé à l’école…
Précisément. Pour cette femme, les camarades de classe de Laïka avaient toujours encore dix ans et le corps de jeunes enfants. Jamais elle ne connaîtrait sa fille adolescente, jamais elle ne pourrait la voir devenir femme. Voir trois ans plus tard un enfant transformé, métamorphosé, était plus que ce qu’elle pouvait tolérer. Elle a entouré doucement le visage de mon garçon de ses mains de mère endeuillée et lui a souri, comme si elle souriait à sa propre fille, revenue des limbes.
Cette scène de grande émotion m’a accompagné tout au long de l’écriture d’Owen Hopkins, Esquire. L’idée première logeait dans cet infini sentiment de perte. Quant aux détails des émotions morbides, je n’ai eu qu’à puiser dans mes souvenirs douloureux d’un accident qui est arrivé à mon garçon quand il était tout petit bébé. Mais, ça, c’est une autre histoire…
Quel fardeau se doit être pour un parent que de continuer à vivre alors que son enfant gît dans son petit cercueil blanc, six pieds sous terre! Continuer ma route sans lui, en aurais-je la force?
Comme dans votre premier livre, il y a dans Owen Hopkins, Esquire des enfants victimes de la violence des adultes. C’est un thème qui vous intéresse particulièrement ?
Tout à fait. Qu’est-ce qu’il peut bien y avoir de pire? Comme professeur de littérature, je me suis rendu compte récemment que je mettais au programme des œuvres dures, impitoyables, où il est fortement question de gamins maltraités. Que les enfants soient victimes de la violence des adultes me bouleverse, mais aussi qu’ils puissent souffrir de leur insouciance, de leur indifférence. Car qui soutiendra les gamins, qui se portera à leur défense sinon les adultes? De voir certaines personnes malveillantes leur infliger des souffrances, leur causer du tort ou abuser d’eux me met hors de moi. Peu de choses m’interpellent plus que l’enfance bafouée. Les enfants sont au cœur de ma vie, il faut croire.
Votre protagoniste est un menteur invétéré. Ne sommes-nous pas tous menteurs dans une certaine mesure ?
Sans doute le sommes-nous tous, oui, à divers degrés. Peut-être pour nous rendre l’existence plus tolérable. Je crois que nous serions tous des monstres insupportables si nous étions contraints en tout temps de nous en tenir à la stricte vérité. Notre vie sociale deviendrait tout simplement impossible. Se pourrait-il que le concept même de civilisation soit fondé sur le mensonge, à tout le moins sur l’altération de la vérité brute? Je suis bien curieux de savoir combien de temps un être humain pourrait tenir sans avoir recours à un maquillage de la vérité… Et des mensonges, il y en a de toutes sortes. Il nous arrive de mentir par vile stratégie, pour nuire à l’autre, parfois sinon pour camoufler un choc brutal, un peu comme on use de l’euphémisme pour atténuer une réalité désagréable, pour ménager des sensibilités. On peut encore mentir par paresse, ou par économie de temps : on peut modifier les détails de la vérité justement pour faire plus court. Peut-être au fond avons-nous besoin du mensonge, par commodité, ou alors sentons-nous une lassitude dans notre quotidien qui fait que nous prenons plaisir à enjoliver les aspects les plus ternes de nos vies. D’où cet intérêt pour l’art, l’artifice, l’artificiel.
De l’art comme mensonge, donc?
C’est Nietzsche qui écrivait : « Nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité. » Si nous devions accorder du crédit à cette idée, il faudrait alors considérer l’art comme une nécessité nous permettant de supporter le monde réel.
Dans vos livres, vous semblez brouiller volontairement la frontière entre la vie et la fiction. L’écriture romanesque n’est-elle pas elle-même une forme de mensonge ?
C’est exact. Je pars d’éléments fortement influencés par le réel et puis je laisse opérer un glissement, un glissement vers le fictif du simple fait que j’écrive là-dessus. Et du coup, tout ce matériau de base participe à la création d’un vaste mensonge. Ma vie ordinaire devient alors un mensonge spectaculaire, au sens où elle est mise en spectacle. Tout cela parce que j’emprunte le détour stimulant de l’imagination. Je m’adonne à un exercice d’imagination qui transforme le réel, qui le mythifie. Je fais dans le recyclage de mon vécu.
Si le brouillage de cette frontière entre la vie réelle et la fiction est effectivement volontaire et calculé, ses causes ou ses motifs m’apparaissent en revanche bien moins clairs. Peut-être que je le fais par pudeur, par instinct de protection de ma vie privée, peut-être encore par simple plaisir de plonger dans le romanesque et de magnifier le réel. Puisque mes parents étaient de sacré bons menteurs, je suis allé à la bonne école, je crois bien.
Y a-t-il des auteurs ou des œuvres littéraires qui vous ont habité durant l’écriture de ce livre?
Assurément certains textes de l’Antiquité grecque. L’anecdote tragique, racontée par Plutarque, de l’enfant spartiate qui a dérobé un renard a d’une certaine façon créé un pont entre les thèmes du mensonge et de l’enfance malheureuse.
Les notions de némésis et d’hybris chères aux Grecs anciens m’habitent aussi, de manière presque obsédante, depuis un an et demi. Il en est d’ailleurs question de manière macrocosmique dans Owen Hopkins, Esquire. Comme une philosophie générale qui engloberait l’ensemble de l’œuvre. Depuis le succès inattendu de Rouge Kubrick, je me suis toujours senti redevable, comme si j’avais contracté une dette, ou bafoué un interdit, plutôt. L’historien grec Hérodote a parlé de la némésis comme d’un châtiment des dieux qui force l’orgueilleux à se rétirer à l’intérieur du cadre limité qu’il a eu l’audace inconsidérée de transgresser. C’est comme si je sentais quelque part au fond de moi que tout ce succès a été édifié sur le dos de ma mère morte. M’est-il permis, au nom de l’art, de jouir des conséquences directes du suicide de ma mère? Quand j’ai écrit, dans Owen Hopkins, Esquire : « Par un juste retour des choses, la némésis finit tôt ou tard par châtier ceux qui éprouvent un excès de bonheur ou encore un orgueil démesuré », je ne pensais qu’à cela. Il m’arrive, dans mes réflexions solitaires, de me sentir terrifié par la suite des choses. En écrivant Ma vie rouge Kubrick et en continuant de récolter les fruits de son succès, ai-je transgressé un tabou? Ai-je commis une faute? J’essaie bien sûr de me convaincre que non, mais en raison d’un mécanisme de pensée plutôt pervers, j’en conviens, je n’y arrive pas toujours.
Enregistrer
Entretien avec GUILLAUME MORISSETTE
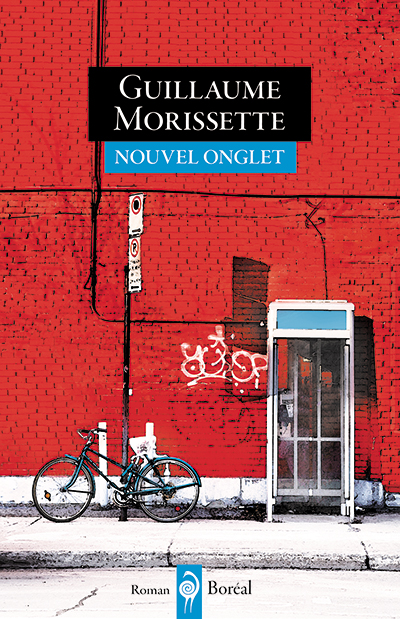 Vous inscrivez très clairement votre roman dans la réalité montréalaise. En quoi celle-ci vous semble-t-elle si particulière ?
Vous inscrivez très clairement votre roman dans la réalité montréalaise. En quoi celle-ci vous semble-t-elle si particulière ?
Nouveau onglet est un roman semi-autobiographique. Mon objectif était d’utiliser certaines expériences personnelles pour donner au texte le pouvoir du réel, mais sans nécessairement basculer dans l’autobiographie pure. Au moment d’écrire Nouvel onglet, je regardais autour de moi et je n’arrivais pas vraiment à trouver un roman qui présentait le Montréal que je connaissais. Au départ, je voulais écrire un roman moderne qui pourrait faire le pont entre les romans montréalais d’auteurs comme Mordecai Richler, Heather O’Neill ou Nelly Arcan, et les romans d’auteurs comme Sheila Heti ou Ben Lerner. Je voulais aussi parler de la communauté anglophone de Montréal de façon réaliste ainsi que de l’omniprésence des plateformes comme Facebook, Twitter, etc., dans nos échanges et nos relations.
Pour un artiste, Montréal possède beaucoup d’avantages. Le coût de la vie est raisonnable, surtout lorsqu’on compare Montréal à Vancouver ou Toronto, ce n’est pas très loin de New York, et le cachet multiculturel de la ville lui donne une personnalité complètement unique. J’aime beaucoup Montréal, et je pense que c’est parce que Montréal, plus que n’importe quelle autre ville, me permet de me comprendre. À Montréal, je peux avoir une identité fluide, pas entièrement francophone et pas entièrement anglophone.
Croyez-vous que vous auriez pu écrire le même roman en français ?
Non. Je fonctionne surtout en anglais ces jours-ci, ce qui fait que je me sens souvent un peu loin de ma langue natale. Je peux évidemment encore écrire et parler en français, mais puisque j’ai investi beaucoup d’heures à apprendre comment manier l’anglais, ma façon d’écrire en français me donne souvent l’impression d’être robotique ou moins inspirée. Je ne crois pas que j’aurais été en mesure d’écrire en français Nouvel onglet, ou n’importe quel autre roman, sans faire un effort pour me rapprocher de ma langue natale. Si je voulais écrire un roman en français, je pense que ma stratégie serait d’aller vivre dans un milieu entièrement francophone (plutôt que le Mile End, où j’habite actuellement, qui est pas mal anglophone), de lire uniquement des romans en français, d’écrire en français tous les jours et d’inonder mon cerveau de français jusqu’à temps que je me sente capable d’écrire un roman semi-potable dans ma langue natale.
Croyez-vous que les lecteurs auront de l’empathie pour vos personnages?
Certains lecteurs vont avoir de l’empathie et d’autres peut-être pas du tout, ce qui ne me dérange pas vraiment. En tant qu’auteur, j’accepte qu’un lecteur amène ses propres idées, ses préjugés, ses expériences, ses opinions, etc., et j’assume aussi toutes les conséquences, positives ou négatives, d’avoir écrit et publié un roman comme Nouveau onglet. Si un lecteur lit mon roman et n’arrive pas à comprendre mes personnages ou à s’intéresser à eux et qu’il m’envoie un courriel pour me crier après, je n’ai aucun problème avec ça. En fait, je risque plutôt de m’intéresser au point de vue de cette personne, qui est probablement différent du mien.
Quel rôle la littérature joue, peut ou doit jouer dans notre société?
L’écriture est ce qui se rapproche le plus de la pensée, et les livres, particulièrement le roman, sont encore l’endroit où on peut trouver les comptes rendus les plus complets, les plus vrais et les plus détaillés de ce que c’est qu’être humain. Si on compare à peu près n’importe quel roman à un film comme Batman v Superman, on constate que le film et le livre ne cherchent pas vraiment à accomplir la même chose. Ce que le film veut, en gros, c’est prendre ton argent, et en échange il promet de te montrer Ben Affleck faisant des grimaces dans un suit de plastique pendant deux heures. La plupart des écrivains ne s’attendent pas à vendre des millions d’exemplaires de leurs livres, donc ils sont motivés par autre chose que prendre ton argent. L’objectif d’un écrivain, en général, c’est de communiquer de façon indirecte avec le lecteur.
Plutôt que de voir les livres d’un point de vue social, je préfère les voir d’un point de vue individuel. Lire, pour moi, c’est un choix personnel. Je lis pour apprendre, je lis pour trouver des solutions à mes problèmes, je lis pour avoir plus empathie, je lis pour être une personne plus intéressante.
Enregistrer
Enregistrer
Entretien avec Alexandre Trudeau
UN BARBARE EN CHINE NOUVELLE
Alexandre Trudeau
Vous avez tourné un documentaire sur la Chine. Vous donnez maintenant un livre. Qu’est-ce que le livre peut dire ou montrer que le documentaire ne peut pas?
Dans le livre je propose une approche quasi documentaire et j’invite le lecteur à m’accompagner dans un long périple à travers la Chine. Un véritable documentaire passe très vite dans le temps. Il ne permet qu’un survol très rapide du sujet. Un livre peut arrêter le temps. Il permet d’ouvrir des brèches dans le récit par lesquelles il nous est possible de pénétrer très, très loin dans un sujet. Dans Un barbare en Chine nouvelle, je pense profiter pleinement de cette liberté littéraire face à l’espace et au temps.
Alors que la Chine nous semble traverser une transformation radicale, vous insistez surtout sur la continuité de sa culture et de sa civilisation. Pourquoi?
Une transformation radicale n’a pas vraiment de sens si nous ne considérons pas l’immensité et l’ancienneté de la culture qui est appelée à se transformer. De plus, je crois davantage à la sédimentation des idées qu’à leur disparition totale. Les ruptures absolues sont très, très rares.
Qu’avons-nous à apprendre de la « Chine nouvelle »?
La Chine nouvelle nous amène à une profonde réflexion sur la question de la liberté. À vrai dire, c’est en comparant notre histoire avec celle de la Chine que nous arriverons à bien cerner l’évolution de la liberté individuelle dans le monde occidental. En comparant la situation en Chine avec celle qui a régné dans le bassin Méditerranéen, par exemple, nous arrivons à mieux percevoir quels éléments géographiques, démographiques et politiques ont rendu cette liberté possible en Occident et non en Chine. Or, la Chine vit actuellement une période de libération socioéconomique intense. Elle continue à se libérer de son passé très contraignant. Parallèlement, je pense qu’il faut remettre en question la liberté individuelle à l’occidentale, aussi chère qu’elle puisse paraître à nos yeux. Elle fait trop abstraction des réalités environnementales et a été édifiée sur le dos de peuples qu’on a subjugués pas la politique ou par les armes. La trajectoire de la Chine nouvelle marque donc certainement un progrès. Mais comme, en Chine, on part de loin, il est possible qu’on y voie s’épanouir une forme de liberté plus équilibrée et mieux adaptée aux nouvelles réalités planétaires comme la diminution des ressources et la surpopulation.
Enregistrer
Entretien avec Ying Chen
Ying Chen
Le héros de votre roman n’est jamais nommé, mais on ne peut s’empêcher d’y voir la figure de Norman Bethune. Pourquoi celui-ci vous intéresse-t-il ?
Norman Bethune est une célébrité en Chine. Comme tous les enfants de ma génération, j’ai dû apprendre par cœur le texte que Mao lui a consacré. Et, comme la plupart des gens de ma génération, j’étais complètement indifférente à toute cette propagande. C’est en arrivant au Canada que j’ai découvert le silence autour de la figure de Bethune, à l’extrême opposé de ce que j’avais connu en Chine. Le cas de Bethune, mort au début de la guerre froide, dans un camp adverse, montre assez clairement comment la réalité est présentée dans les médias, selon l’époque ou les intérêts politico-économiques.
Vous semblez porter un jugement très sévère sur la Chine actuelle. Pourquoi ?
Je ne crois pas que mes opinions envers la Chine actuelle soient sévères. Je n’en suis pas capable, sentimentalement parlant. Et je n’en ai pas le droit, étant donné l’évolution extrêmement complexe de ce pays, évolution dont je ne connais pas tous les tenants et aboutissants. Je suis par contre en désaccord avec l’idée selon laquelle le monde entier devrait suivre un seul et même modèle de développement, soumis à une seule loi, celle du capital et du marché.
Ce roman, avec sa portée historique et politique, marque une rupture avec vos précédents titres. Cela reflète-t-il de nouvelles préoccupations chez vous ?
Il y a un changement de procédé, mais sans rupture par rapport à mon point de vue sur l’histoire, sur les événements du présent et du passé, sur la relativité des vérités. Le docteur Bethune, malgré l’adoucissement récent et assez pragmatique des opinions à son égard, reste aujourd’hui encore, et peut-être plus que jamais, une figure dissidente, donc actuelle. Et je trouve que notre époque si tumultueuse aurait grand besoin d’une telle dissidence.
Peut-il y avoir encore des figures héroïques dans le monde d’aujourd’hui? Est-ce souhaitable?
Ce sont les époques qui produisent, ou non, les figures héroïques, qu’on le souhaite ou non. Notre époque est dominée par des puissances invisibles.
Enregistrer
Enregistrer
Paroles et réflexions d’une féministe pressée
Daniel Raunet
MONIQUE BÉGIN. ENTRETIENS
Que diriez-vous à ces jeunes femmes engagées aujourd’hui en politique qui tiennent à préciser qu’elles ne sont pas féministes?
Je leur demanderais si les femmes, que ce soit chez nous ou ailleurs, jouissent de droits égaux à tous égards. Elles me répondraient : « Non! » Et je rétorquerais : « Vous êtes donc féministes! » Je pousserais en disant : « Mais pourquoi, à travail de valeur égale, les salaires des femmes sont-ils inférieurs de 30% à ceux des hommes au Canada aujourd’hui? Et de 32 à 34% en ce qui concerne les professeures de nos universités? Et ainsi de suite! »
En vous lisant, on a l’impression que, à l’époque où vous étiez en politique, il était possible – au prix de grands efforts, certes – de faire changer les choses rapidement et de manière importante. Aujourd’hui, le monde politique donne l’impression d’un certain immobilisme. Qu’est-ce qui a changé? la politique? ceux qui la font?
Non, quand j’étais en politique, comme aujourd’hui, le problème, ce n’était pas l’immobilisme, c’était, c’est le « gradualisme ». Nous gouvernons par des « approches à petits pas ». Tout ce que j’ai réussi à faire, je l’ai fait sur plusieurs années : la Loi canadienne sur la santé, la bonification des pensions, la dévolution des services de santé aux Premières Nations et tout le reste. D’où ma diatribe, désormais célèbre, il y a dix ans : le Canada est le pays des projets pilotes! Les politiciens n’agiront jamais s’ils ne sont pas sûrs qu’il y ait une demande réelle; que l’inaction puisse leur faire mal; et que la pression ne les lâchera pas. Malheureusement, ils n’entendent pas, ou mal, les demandes de la population. Par opposition, mon crédit d’impôt enfant (les prestations aux enfants et aux familles) fut un coup militaire réussi dans des circonstances exceptionnelles. De même, Justin Trudeau a su saisir au vol les besoins des classes moyennes et il y a répondu dans son premier budget, profitant de l’engouement exceptionnel de son élection en 2015.
Enregistrer
Entretien avec Luc-Alain Giraldeau
Luc-Alain Giraldeau
Vous dites que l’étude du comportement des oiseaux est susceptible de nous en apprendre tout autant, sinon plus, sur celui des humains que l’étude des chimpanzés. Comment cela est-il possible ?
Parce que l’évolution, ce n’est pas seulement l’héritage de caractères ancestraux, mais aussi la transformation de cet héritage en réaction à des pressions exercées par l’environnement. Ainsi, plusieurs animaux dont les ancêtres n’ont rien de semblable ont néanmoins évolué vers des caractères ressemblants, parce qu’ils vivaient dans des conditions écologiques similaires. C’est ce qui explique, par exemple, la ressemblance externe du requin et du dauphin, un poisson et un mammifère. Dans plusieurs circonstances, notre comportement humain a évolué en réponse à des pressions externes qui ont pu être les mêmes que celles rencontrées par des espèces autres que les primates, comme les oiseaux. Le partage de conditions environnementales peut être aussi important que le partage d’ancêtres; ce que nous partageons avec les primates, en réalité, est alors le fait d’une absence d’évolution.
Vous montrez que la culture qui caractérise l’espèce humaine est le fruit de l’évolution. En même temps, vous nous dites qu’il est impossible de se servir de notre connaissance du monde animal pour juger les comportements humains. N’est-ce pas contradictoire ?
Non, pas du tout. Ce que je dis, c’est que la nature n’est pas le fruit d’un créateur qui nous montrerait par son œuvre ce qui est bon ou mauvais. La nature vivante est le fruit de l’évolution, qui fonctionne avec sa propre logique, aveugle et froide, générant des comportements quelquefois admirables mais souvent carrément répugnants. La nature ne peut donc pas nous servir de caution morale pour juger du bien et du mal. La culture est aussi le produit de l’évolution et, de ce fait, elle n’est ni bonne ou mauvaise.
Vous dites que la biologie est la seule science où deux causes peuvent expliquer le même phénomène. Pourriez-vous nous donner un exemple?
Oui, bien sûr. Lorsque je mange un repas, c’est généralement parce que j’ai faim. La faim est pour moi la cause immédiate de mon comportement alimentaire. Mais, à bien y penser, je mange aussi pour rester en vie, pour alimenter mon corps et me permettre un jour de produire une descendance. Si je ne mangeais pas, je mourrais à coup sûr. Manger pour survivre et se reproduire est la cause plus lointaine, ou évolutive, de ce comportement. Lorsque je mange, je ne pense pas à la mort que j’évite, mais il n’en demeure pas moins que je mange aussi pour rester en vie. Un comportement, deux causes.
Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de votre livre?
Que nous, humains, nous sommes, comme tous les êtres vivants, le résultat de l’interaction éphémère entre deux histoires, une histoire qui nous est léguée par notre lignée, nos gènes, et notre histoire propre, notre histoire anecdotique. Pour comprendre l’humain, il faut accepter cette interaction; c’est elle qui ouvrira ensuite la voie aux échanges entres les sciences humaines et la biologie.
Vous dites de l’évolution qu’elle est un processus sans but précis qui n’a rien à voir avec la notion de progrès. N’est-ce pas là une invitation au cynisme?
Non, pas du tout. Pour moi, une compréhension claire de l’absence de dessein dans l’évolution nous place devant notre responsabilité distincte, celle de penser le bien et le mal sans chercher la caution de la nature. C’est à nous de décider ce qui est acceptable, et ce n’est pas toujours facile.
Vous avez récemment dit que vous étiez très heureux que votre livre se retrouve dans une maison d’édition qui publie également des œuvres littéraires. Pourquoi?
Je trouve dommage que, pour diverses raisons, il faille imposer très tôt aux élèves un choix entre un cursus qui les mènera aux humanités, un autre qui les mènera aux arts et un autre aux sciences naturelles. Mon livre s’adresse donc à tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ont choisi de laisser les sciences naturelles au fond de leur pupitre d’école. Je crois que l’activité scientifique, la vraie, n’est pas très différente de l’activité artistique. Dans les deux cas, on imagine le monde dans lequel on se retrouve et on tente de l’expliquer. Nos contraintes disciplinaires sont certes différentes, mais au départ notre créativité est bien la même. La science, celle dont je parle dans ce livre, offre une vision étonnante du monde, capable de rivaliser avec des versions plus artistiques. Je veux partager cela avec les lecteurs. Qui sait, peut-être en seront-ils inspirés? C’est, je crois, ce qui me réjouis d’être édité par une maison qui publie aussi bien un essai de sciences naturelles ou de science politique qu’un roman. Je suis très heureux de faire partie d’une maison qui considère que la science fait partie de la culture.
Enregistrer
Enregistrer
Entretien avec Virginie Blanchette-Doucet
Virginie Blanchette-Doucet
Maude, votre protagoniste, navigue dans un monde d’hommes. Qu’est-ce qui vous a amenée à vous intéresser à eux ?
Le hasard a fait que je suis la plupart du temps entourée de garçons et d’hommes. Ça a toujours été « normal » pour moi, alors j’ai trouvé intéressant d’installer ma narratrice dans le même contexte.
Vos personnages entretiennent une relation très particulière avec le territoire qu’ils habitent, l’Abitibi. Comment décririez-vous cette relation ?
Le territoire, pour mes personnages, est une question identitaire, nécessaire, vitale. De pouvoir dire « C’est de là que je viens » est une certitude qui les habite et qu’ils ne pensaient pas fragiliser.
Qu’en est-il de la tension entre Montréal et l’Abitibi, si présente dans votre roman?
Le déracinement est au cœur de ma réflexion. C’est quoi, partir? Et revenir? Qu’y a-t-il, qui sommes-nous, entre les deux? Je pense que je ne le sais pas encore. Un peu mieux qu’avant, mais pas encore.
Votre roman est composé de fragments. Pourquoi avoir choisi cette forme ?
Je pense que c’est la forme qui m’a choisie, et non l’inverse! Les sensations me viennent en premier. La forme brève a l’avantage de me permettre de condenser l’émotion, de travailler comme le ferait un orfèvre, peut-être.
Votre protagoniste transforme une situation dramatique, l’expropriation de sa maison par une société minière, en une possibilité de changement, d’évolution, voire de libération. Est-ce consciemment que vous résistez à la mélancolie et au spleen qui traversent bon nombre d’œuvres contemporaines?
La résilience est très belle. Après, ce qui est conscient ou pas, je n’oserais me prononcer. Ma narratrice avait besoin de cet élan vers l’avant pour exister dans le roman.
« On sent qu’il y a une voix d’écrivaine, qu’elle a des choses à dire et qu’elle le fait très, très bien. Un très bon début de carrière pour Virginie Blanchette-Doucet. »
Anne Michaud, Les Matins d’ici, Radio-Canada Première
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Tél: (514) 287-7401 Téléc: (514) 287-7664
Les photos des auteurs ne peuvent être reproduites sans l'autorisation des Éditions du Boréal.