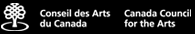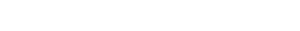Nouvelle parution: Pages à brûler, le nouveau roman de Pascale Quiviger
Tous les détails sur le livre sont ici.
Frankfurt Bookfair 2010
Boréal’s stand will be located in Hall 6.1-A905. The fall rights catalog is now available.
Quatre questions à Michel Biron
–

Michel Biron
Professeur de littérature québécoise à l’Université McGill, Michel Biron a publié en 2000 L’Absence du maître, Saint-Denys Garneau, Ferron, Ducharme (prix Jean Éthier-Blais). Il est aussi le coauteur d’une magistrale Histoire de la littérature québécoise (Boréal, 2007; prix Gabrielle Roy et prix Jean Éthier-Blais). Son essai La Conscience du désert vient de paraître au Boréal, et nous l’avons questionné à ce sujet…
–
Qu’avez-vous cherché à faire, dans cet ouvrage?
En gros, j’ai voulu réfléchir au monde dans lequel je vis en m’appuyant non pas d’abord sur des faits historiques, des données sociologiques ou des réalités anthropologiques, mais sur des textes littéraires. À travers des œuvres d’auteurs anciens ou contemporains, québécois ou étrangers, j’essaie de voir ce qui change dans mon monde, mais aussi ce qui me rattache au passé et ce qui me rapproche de ce qui s’écrit ailleurs. De tels textes me permettent aussi d’observer ce que devient la littérature dans un monde comme le nôtre. À vrai dire, mon interrogation est double: en premier lieu, je me demande ce qu’est la littérature dans une société comme la québécoise, où la tradition d’écriture demeure fragile, où les textes les plus forts sont ceux qui assument la fragilité même de cette tradition; en second lieu, je pose aussi la question de façon beaucoup plus générale, car la désintégration relative de la littérature à laquelle on assiste depuis environ 1970-1980 dépasse, de loin, le seul cas du Québec.
–
Qu’est-ce que cette «conscience du désert» qui marque selon vous la littérature québécoise?
Toute la littérature québécoise est peuplée de personnages qui s’évadent vers le désert qu’est le Nord. L’exemple pour moi le plus éclairant est celui du père de Maria Chapdelaine qui ne peut supporter le fait d’avoir des voisins et «mouve» toujours plus au Nord, là où il n’y a encore personne, là où l’individu est soi-disant libre, dégagé de toute tradition contraignante, mais exposé aux vertiges mêmes que cette liberté entraîne. Du «monde irrémédiable désert» de Saint-Denys Garneau aux «mondes peu habités» de Pierre Nepveu, il y a là une constante qui me paraît tout à fait significative. On peut certes l’interpréter de façon négative en parlant du Québec comme d’un «désert culturel», et il n’est pas rare de trouver des remarques en ce sens chez les écrivains comme chez les critiques. Il est encore moins rare de trouver des commentateurs enthousiastes qui défendent la thèse inverse avec un optimisme aussi sympathique que suspect. Or, de mon point de vue, le mot-clef dans l’expression «conscience du désert» est le mot «conscience». Il suppose une lucidité et une force qui sont à la base de l’écriture. Plusieurs auteurs (parmi les meilleurs), loin de chercher naïvement à vouloir prouver que le «désert» n’en est pas un, font de la «conscience du désert» le moteur de leur écriture et le lieu par excellence de leur imaginaire. Ce sont ces écrivains qui sont analysés dans mon ouvrage.
–
Vous faites référence au modèle belge, qui pourrait inspirer le rapport québécois à la littérature. Dans quel sens?
La Belgique, pour moi, est une sorte d’antidote idéal à la «surdose nationaliste» propre à la littérature québécoise. Quand je parle à mes amis belges, l’idée même d’une littérature «nationale», «régionale» ou «locale» les fait sourire. Il y a, oui, des écrivains belges, comme Simenon et Henri Michaux, mais leur identité nationale (ou régionale) importe assez peu. Ce sont des écrivains. De nombreux critiques ont montré qu’il y a, malgré tout, une «belgitude» qui peut se lire à même ce refus de l’identité nationale (ou régionale), mais cela ne change rien au fait que ces écrivains appartiennent d’abord à la littérature. Une telle phrase, j’en conviens, était naguère le comble du conformisme universalisant et sentait la poussière de l’humanisme. Aujourd’hui, il me semble qu’elle a quelque chose de scandaleux et de nécessaire. D’où l’idée du «modèle belge», étant entendu qu’une telle expression est une forme de contradiction dans les termes.
–
Parlez-moi un peu de ce que vous qualifiez de cassure dans le lien entre les écrivains québécois et la littérature française?
C’est un constat assez simple: l’écrivain québécois de 1960 ou de 1970 a été formé à la littérature à partir des modèles classiques français; l’écrivain québécois de 1990, lui, a grandi en ayant des modèles littéraires québécois. Les classiques français lui sont encore familiers, mais dilués dans un ensemble hétérogène et sans constituer sa véritable tradition: c’est une tradition parmi d’autres. Entre des écrivains d’hier comme Ducharme ou Aquin et des écrivains d’aujourd’hui comme Louis Hamelin ou Nicolas Dickner, la cassure est radicale, d’autant plus radicale qu’elle n’a pas fait l’objet d’une revendication particulière, qu’elle s’est imposée d’elle-même. Il me semble qu’on n’a pas encore pris la mesure de cette cassure.
***
Pour feuilleter le livre, cliquer ici.
Tous les détails sur le livre sont ici.
Nouvelle parution: La Conscience du désert, Essais sur la littérature au Québec et ailleurs, par Michel Biron
Tous les détails sur le livre sont ici.
Nouvelle parution: Espèces, le nouveau roman de Ying Chen
Tous les détails sur le livre sont ici.
Are you married to a psychopath ?
The latest collection of short stories by Nadine Bismuth has just been released in English by McArthur & Co. The author will be attending the International Festival of Authors (Toronto) next October to present her book.
The film rights have also been sold this summer to Max Film.
Quatre questions à Marcel Martel et Martin Pâquet

Martin Pâquet

Marcel Martel
Marcel Martel est professeur d’histoire et titulaire de la Chaire Avie Bennett Historica en histoire canadienne à l’Université York de Toronto. Martin Pâquet est quant à lui professeur au Département d’histoire de l’Université Laval et titulaire de la Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d’expression française en Amérique du Nord (CÉFAN). Ensemble, ils signent Langue et politique au Canada et au Québec, une ample synthèse de l’histoire du rapport entre langue et politique chez nous, qui vient de paraître au Boréal.
–
Pourriez-vous d’abord me résumer le propos de votre ouvrage?
Martin Pâquet [MP]: Notre synthèse historique explore les rapports historiques entre langue et politique au Canada et au Québec, du premier édit en matière linguistique par François 1er en 1539 jusqu’à nos jours. Pour nous, la langue est plus qu’un simple outil de communication; elle est porteuse de culture, d’identités et de projets nationaux, car elle est constamment présente dans les relations entre les individus. L’étude des rapports entre la langue et l’histoire reflète aussi les normes et les rapports de force présents en société. Elle révèle aussi les aspirations d’une communauté et la manière dont elle se projette dans l’avenir.
Marcel Martel [MM]: Notre ouvrage retrace l’évolution de l’enjeu linguistique et ses changements au fil des ans. En matière linguistique, le contexte historique est indispensable pour comprendre l’action politique. De la Conquête à la Révolution tranquille, de la crise du Règlement 17 aux différents jugements de la Cour suprême, les contextes varient et influencent les différents statuts de la langue, ce qui engendre de vives résistances et des débats souvent virulents. Ces débats suscitent une forte mobilisation des citoyens, dans la rue, dans les médias ou devant les tribunaux, des citoyens profondément soucieux de la reconnaissance de leur langue et de leurs droits. Notre ouvrage accorde une place importante aux individus et organismes qui ont transformé la question linguistique en un enjeu politique qui requérait l’intervention de l’État. Ainsi aux XIXe et XXe siècles, les individus opposés au fait français et ceux, au contraire, qui demandent le bilinguisme officiel ou, dans le cas du Québec, l’unilinguisme comme politique linguistique, obligent les États fédéral comme provinciaux à intervenir.
MP: Pourquoi les responsables politiques veulent-ils intervenir? Nous avons identifié deux objectifs majeurs: sur leurs territoires respectifs, les États cherchent à assurer à la fois une population homogène et la paix civile. Tout au cours de l’histoire des rapports entre langue et politique, surtout au cours des deux derniers siècles, toute une série de crises liées intimement à la construction nationale et à la domination socio-économique, éclatent. Dès lors, les responsables politiques, des élus et fonctionnaires au sein des États fédéral et provinciaux, mais aussi des membres des élites communautaires, veulent réduire le potentiel de désordre en mettant en place des dispositifs. S’inscrivant aussi dans une politique de la reconnaissance et de la gestion de la diversité, ces dispositifs sont diversifiés, allant des politiques d’aménagement linguistique aux recours aux tribunaux, en passant par la gamme des gestes symboliques et par la surveillance par les corps policiers, comme la GRC.
–
Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser au rapport entre la langue et la politique au Canada et au Québec? Y avait-il des manques dans la littérature existante?
MM: Nous avons écrit cet ouvrage puisqu’il n’existe pas de synthèse historique sur les expériences canadienne et québécoise en matière des rapports entre langue et politique. Notre livre permet au lecteur de comprendre les transformations du débat sur la langue, non seulement à partir de 1867 ou de 1982, mais dès les origines. De plus, nous tenions à comprendre l’enjeu linguistique dans toutes ses spécificités, afin de mieux saisir les termes de cet enjeu selon les sociétés qui les vivent. C’est pour cette raison que nous nous sommes intéressés à la scène fédérale, au Québec, aux provinces anglophones, aux communautés immigrantes et aux peuples autochtones. Si la question linguistique a fait les manchettes au Québec, il en est de même ailleurs au Canada, mais d’une manière différente.
MP: En couvrant plus de 400 ans, notre ouvrage adopte résolument une perspective globale, ce qui permet de mieux cerner les enjeux, mais surtout le chemin parcouru depuis l’arrivée du premier Européen en Amérique du Nord jusqu’aux événements récents. D’autres ouvrages traitent de la question linguistique en privilégiant l’action des tribunaux ou en analysant les variations de la langue parlée et écrite. Quant à notre ouvrage, il s’intéresse plus largement au politique et à la politique en offrant un regard neuf sur des questions très actuelles: celle de la vie en société, du partage d’une langue commune et du pluralisme culturel. Comment la langue témoigne-t-elle du «vouloir-vivre» au sein de toute communauté? Comment les normes du «devoir-vivre» collectif font-elles une place à l’expression de langues différentes? Comment les débats linguistiques sont-ils des manifestations du «comment-vivre» en société? Ces questions nous semblent fondamentales, car elles touchent à des aspects cruciaux de nos sociétés contemporaines.
–
Vous divisez votre synthèse en six grandes époques historiques. Malgré les caractéristiques propres à chacune de ces époques, voyez-vous un fil conducteur dans le rapport qu’ont entretenu la langue et la politique chez nous?
MM: Notre synthèse montre que ce fil conducteur se compose de plusieurs brins. L’un d’entre eux est la constance de l’action citoyenne. Depuis les origines, ce sont les citoyens qui manifestent en faveur du maintien et de la promotion de leurs droits à s’exprimer dans leur langue, car parler une langue, c’est vivre dans une communauté qui a un passé, un présent et un avenir. Par exemple, la manière dont les Québécois, les Acadiens, les Franco-Ontariens, mais aussi les peuples amérindiens ont débattu la question de la langue, atteste des moyens mis en œuvre pour être reconnus comme ils ont été, sont et seront.
Un autre brin est aussi la permanence du rôle de l’État, tout particulièrement avec les lois et l’action des tribunaux. Les diverses lois, adoptées au fil des ans, par les responsables politiques, reflètent les rapports de force à l’intérieur des sociétés qui forment le Canada et le Québec. Certaines lois réduisent les droits des citoyens en niant leur diversité linguistique et culturelle: c’est le cas des politiques linguistiques adoptées au XIXe et au XXe siècle au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Alberta et en Saskatchewan qui visent à réduire la place publique réservée au français. D’autres lois cherchent au contraire à faire la promotion du bien commun d’une communauté en reconnaissance une place centrale à la langue publique: c’est le cas des lois promouvant le français comme langue commune au Québec, ou celles favorisant l’usage du français ailleurs au Canada.
MP: Nous insistons sur cette tendance forte: la langue traduit les rapports de force dans une société. Avant le XIXe siècle, la confession religieuse occupe la place centrale bien plus que la langue. L’ère des révolutions — Révolution française, révolution industrielle, etc. — transforme les rapports de force qui sont désormais axés sur la domination socioéconomique. Dès lors, la langue est au cœur de la Nation — nation britannique d’abord, nation canadienne — française ensuite. Elle est aussi au centre de la division entre le capital – ceux qui possèdent et qui parlent anglais — et le travail — ceux qui vendent leur force de travail et qui parlent français ou une autre langue. Les conflits linguistiques des années 1960 ne sont pas que des luttes pour parler le français: ils traduisent des projets nationaux, un refus d’être minoritaire et une forte volonté de promotion socioéconomique. Lutter pour le français à Montréal ou à Moncton, c’est aussi lutter pour de meilleures conditions de vie. Ce n’est pas abstrait, mais au contraire très concret.
–
Qu’est-ce qui caractérise notre époque actuelle, que vous identifiez comme débutant en 1982? Voyez-vous des éléments qui vous permettent de penser que cette période pourrait prendre fin dans un avenir envisageable?
MP: Nous ne sommes pas des astrologues, mais des historiens. Heureusement! Toutefois, nous sommes persuadés que la connaissance du passé permet de comprendre le présent et, ce faisant, de pouvoir influencer ce que sera l’avenir. Nous avons constaté que le rapport à la langue s’est modifié depuis 1982, non seulement à cause du recours aux tribunaux et de la promotion des droits individuels, mais aussi par l’impact du marché dans toutes les sphères de la vie. Pour plusieurs contemporains, parler le «business English» est un moyen pour commercer aisément à travers le monde. Dès lors, les dangers pour la diversité culturelle et linguistique sont grands, puisqu’il apparaît moins utile aux yeux de plusieurs de conserver une autre langue — le français, par exemple. Ce faisant, la manière que nous vivons ensemble et la façon dont nous voyons le monde risquent de s’atrophier, au péril de notre richesse collective.
MM: Il y a néanmoins de l’espoir, car les citoyens peuvent toujours prendre la parole pour le maintien et la promotion de leur langue. Ils peuvent réactualiser des causes comme celle de la nation. Ils peuvent se servir des nouveaux médiums de communication tels qu’Internet. Ils peuvent se mobiliser à la manière des groupes altermondialistes pour revendiquer des changements et les obtenir. La langue est une conquête de la vie: tant que nous vivons et voulons vivre, nous pouvons assurer la diversité de notre monde.
–
Pour feuilleter le livre, cliquez ici.
Tous les détails sur le livre sont ici.
Trois questions à Michael Delisle
 Michael Delisle est poète, romancier et nouvelliste. Il est lauréat du prix Émile-Nelligan (Fontainebleau, 1987) et du prix Adrienne-Choquette (Le Sort de fille, 2005). Son nouveau roman, Tiroir No 24, vient de paraître au Boréal.
Michael Delisle est poète, romancier et nouvelliste. Il est lauréat du prix Émile-Nelligan (Fontainebleau, 1987) et du prix Adrienne-Choquette (Le Sort de fille, 2005). Son nouveau roman, Tiroir No 24, vient de paraître au Boréal.
–
Que raconte votre roman?
Tiroir No 24 raconte l’histoire d’un orphelin, Benoit, de son adoption par des commerçants montréalais à la veille de l’Expo 67 jusqu’à son renvoi, à l’été 80. En trame de fond, le monde des traiteurs, le Québec ancien et sa culture, le Québec moderne et son effervescence.
–
Le Québec est donc un élément important de votre roman, en particulier dans son passage à la modernité. Qu’est-ce qui vous a donné envie de traiter de cette transition?
Mes romans traitent souvent de personnages qui n’arrivent pas à suivre dans une période de transition. Chez les historiens, on aime les héros du changement; je comprends ce goût pour la «figure d’incarnation» de son époque mais pourquoi négliger ceux qu’on pourrait appeler les «martyrs de la transition», les incapables qui créent une force d’inertie, les résistants qui s’accrochent au passé, qui échouent dans la nouvelle vie qu’on leur propose? Raconter leur histoire est aussi fascinant et, peut-être, plus instructif.
–
Votre oeuvre en tant que poète a été saluée autant que celle du romancier et nouvelliste que vous êtes aussi. Comment une forme s’impose-t-elle, quand vous vous mettez au travail?
J’ai deux vies d’écrivain : poésie et prose. À l’origine de mes projets narratifs, il y a souvent un fait divers, une anecdote, un cas réel. Dans le cas de Tiroir No 24, il y a vraiment eu, en octobre 1980, un garçon de boulangerie qui a incendié un commerce rival. Au fil de mes recherches (historiques, lexicales), je me suis approprié le sujet, j’ai glissé vers la fiction, un mode qui m’apporte plus de plaisir que la relation pointilleuse des événements passés.
Roman ou nouvelle? Ce n’est pas aussi tranché. On dit de mes nouvelles que ce sont de petits romans et mes chapitres de romans sont pensés comme des nouvelles.
–
Pour feuilleter le livre, cliquez ici.
Tous les détails sur le livre sont ici.
Réussir son hypermodernité et sauver le reste de sa vie en 25 étapes faciles: un avant-goût vidéo
Le livre sera en librairie le 14 septembre. Tous les détails sont ici.
Nouvelle parution: Langue et politique au Canada et au Québec, de Marcel Martel et Martin Pâquet
Tous les détails sur le livre sont ici.
- « Page précédente
- Page 102 de 110
- Page suivante »
Tél: (514) 287-7401 Téléc: (514) 287-7664
Les photos des auteurs ne peuvent être reproduites sans l'autorisation des Éditions du Boréal.