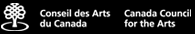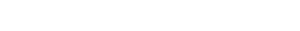Une année faste pour les œuvres publiées par les Éditions du Boréal
Montréal, le 15 novembre 2023
L’année 2023 a été particulièrement riche pour les auteurs et autrices des Éditions du Boréal, dont plusieurs ont été récompensés par de prestigieux prix littéraires ou dont les œuvres ont rayonné au niveau international, grâce aux nombreuses cessions de droits.
Le 22 novembre, Robert Lalonde recevra le prestigieux prix Athanase-David, la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec à une personne pour sa contribution remarquable à la littérature québécoise. Le 8 novembre, Catherine Ego s’est vu décerner le Prix littéraire du Gouverneur général, catégorie « Traduction », pour Dans l’ombre du soleil, d’Esi Edugyan. En mars, le Prix des cinq continents de l’Organisation internationale de la francophonie a été attribué à Monique Proulx pour Enlève la nuit. La romancière sillonne le monde depuis lors (Europe francophone, États-Unis, Roumanie).
En 2023, les œuvres du Boréal ont rayonné sur la scène internationale grâce à la concrétisation de nombreuses cessions de droits. Les Enfants de chienne, de Nicolas Delisle-L’Heureux, publié en début d’année par Les Avrils sous le titre Un grand bruit de catastrophe, a été couronné du Prix Marie-Claire 2023. Le récit de Lori Saint-Martin, Pour qui je me prends, paru cet automne aux Éditions de l’Olivier, a été encensé par la presse française. Des ententes avec les Éditions de l’Aube, les Éditions Dépaysage, les Éditions du sous-sol et les Éditions Do ont permis aux œuvres de Jean-François Létourneau, Serge Bouchard, Mordecai Richler et Jacques Benoît de circuler dans l’Hexagone. Le succès international de l’œuvre de Marie-Claire Blais se poursuit avec la parution en espagnol (Penguin Random House) et en anglais (Second Story Press) d’Un cœur habité de mille voix, au Danemark de La Belle Bête et en Roumanie de Soifs. Le roman Manam, de Rima Elkouri, déjà traduit en anglais et en espagnol, est désormais disponible en version arabe.
Le rayonnement international des œuvres du Boréal sera tout aussi foisonnant en 2024, avec notamment la parution en janvier, en France, de La Maison de mon père, d’Akos Verboczy (Le bruit du monde) et Mort à la baleine, de Farley Mowat (Glénat), ainsi que la parution en Italie d’Augustino et le chœur de la destruction, de Marie-Claire Blais. Lise Tremblay verra deux de ses romans traduits à l’étranger, Rang de la Dérive enSuède et L’Habitude des bêtes en Roumanie. Noces de coton, d’Edem Awumey, sera offert en version espagnole en Espagne et au Mexique ainsi qu’en version anglaise. Le récit de Laure Morali, En suivant Shimun, et le Journal de Marie Uguay seront également disponibles en anglais au Canada et dans le reste du monde. Toujours grâce aux cessions de droits, les Poèmes de Marie Uguay paraîtront en Belgique (L’arbre de Diane), tandis qu’Un bien nécessaire, de Lori Saint-Martin, sera lancé en Pologne et Enlève la nuit, de Monique Proulx, au Vietnam. Monique Proulx verra aussi son roman traduit en roumain et en arabe. (Liste détaillée des cessions de droits 2023-2024)
Si les œuvres se lisent, elles se jouent aussi sur les planches des théâtres grâce à plusieurs adaptations qui ont circulé en 2023, notamment celles produites par le Festival international de littérature : Ma vie rouge Kubrick, de Simon Roy, adapté et mis en scène par Éric Jean (coproduction Les 2 Mondes), une adaptation fabuleusement interprétée par Maxim Gaudette; Lettres biologiques et Lettres au frère Marie-Victorin, la correspondance scientifique et sentimentale entre le frère Marie-Victorin et Marcelle Gauvreau adaptée pour la scène et interprétée par Yanick Villedieu et Marika Lhoumeau. Cette correspondance a également été portée à l’écran par Lyne Charlebois, sous le titre Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. Ce film produit par Roger Frappier, Sylvie Lacoste et Veronika Molna, qui sortira en salle le 19 juillet 2024, a été couronné à la fin octobre par le Grand Prix Hydro-Québec au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue.
L’un des événements théâtraux marquants du printemps 2024 sera indéniablement l’adaptation par Kevin Lambert d’Un cœur habité de mille voix, de Marie-Claire Blais, dans une mise en scène de Stéphanie Jasmin et Denis Marleau. La pièce, une collaboration entre UBU et l’Espace Go, sera jouée du 2 au 28 avril 2024.
Enfin, rappelons que le Boréal inaugurera en janvier 2024 sa toute nouvelle résidence d’écriture Marie-Claire-Blais. La personne choisie se consacrera pendant six mois à un projet d’écriture, tout en profitant de l’hospitalité de la maison et des conseils de l’équipe éditoriale.
Fondé à Trois-Rivières en 1963, le Boréal est l’un des principaux éditeurs littéraires francophones du pays avec plus de 2 300 titres actifs. Sous l’impulsion de ses codirecteurs Gilles Ostiguy et Renaud Roussel, en poste depuis novembre 2022, la maison poursuit sa mission de maintenir vivante la littérature d’ici, en accompagnant les projets de ses auteurs et en ouvrant la voie à de nouvelles voix audacieuses, percutantes, originales et, surtout, extrêmement talentueuses.
-30-
Source : Éditions du Boréal
Renseignements : Gabrielle Cauchy, attachée de presse
514 336-3941 poste 229, gabrielle.cauchy@dimedia.com
Résidence d’écriture Marie-Claire-Blais 2023

Montréal, le 11 octobre 2023
À l’occasion de leur soixantième anniversaire, les Éditions du Boréal sont heureuses d’annoncer le lancement de la résidence d’écriture Marie-Claire-Blais, en hommage à la grande écrivaine récemment disparue. Fidèle à son œuvre de mentorat auprès des jeunes auteurs et autrices, notamment ceux et celles issus de communautés marginalisées, cette résidence dotée d’une bourse de 1 000 dollars est destinée à toute personne de moins de quarante ans qui désire publier un premier livre de fiction.
C’est l’occasion de se consacrer pendant six mois à un projet d’écriture en cours tout en profitant de l’hospitalité de la maison, sise depuis peu au cœur du quartier Saint-Henri, et des conseils de l’équipe éditoriale, sans obligation de publication au Boréal.
La résidence en bref
Quand ? Du 15 janvier au 17 juin 2024, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, à raison d’au moins deux jours par semaine.
Où ? Dans un espace confortable et propice à la création : un bureau fermé équipé d’un ordinateur avec Internet ainsi qu’une table de travail en aire ouverte.
Et aussi… Une bourse de 1 000 dollars versée au début et à la fin de la résidence.
La présence et l’écoute des éditeurs et des autres artisans de la maison.
Un accès à la cuisine, à la salle commune et à la salle de sports du bâtiment.
Conditions d’admissibilité
• Avoir moins de quarante ans en date du 1er janvier 2024.
• Être citoyen·ne canadien·ne ou résident·e permanent·e du Canada.
• N’avoir jamais publié de livre de fiction.
• Travailler à un projet de livre de fiction en français.
Dossier de candidature
• Une lettre de présentation avec une description du projet d’écriture.
• Un curriculum vitae à jour.
• Un extrait de 3 000 à 5 000 mots du manuscrit en cours.
Les dossiers de candidature doivent être envoyés avant le lundi 4 décembre par courriel à l’adresse suivante : residence@editionsboreal.qc.ca.
Nous ne communiquerons qu’avec les candidat·e·s retenu·e·s.
Les Éditions du Boréal célèbrent leur 60e anniversaire

Montréal, le 12 juin 2023. Les Éditions du Boréal célèbrent cette année leur soixantième anniversaire. Fondée à Trois-Rivières en 1963, la maison a su s’imposer au fil des décennies comme un des principaux éditeurs littéraires francophones du pays et compte aujourd’hui plus de 2 300 titres actifs. Pour souligner ce jalon important, elle organisera, à l’automne 2023, une série d’activités littéraires en librairie et dans les salons du livre.
Coiffées du slogan « Libre de raconter », ces activités seront placées sous le signe de la rencontre et du partage. Causeries, tables rondes et conférences réuniront de nombreux auteurs de différentes générations autour d’une variété de thèmes qui inspirent leurs œuvres. Un accent particulier sera mis sur la richesse du catalogue de la maison, qui a toujours promu la diversité des genres, des styles et des idées. Le Boréal souhaite ainsi créer un espace de réflexion et d’inspiration pour les auteurs et les lecteurs.
Ces activités littéraires s’accompagneront d’une vaste campagne éditoriale qui proposera de belles éditions « collector » à couverture rigide et à tirage limité de douze œuvres parmi les titres incontournables du Boréal. Cette sélection, inspirée d’un palmarès établi par les libraires, mettra à l’honneur des textes de Gilles Archambault, Nadine Bismuth, Marie-Claire Blais, Serge Bouchard, Michael Delisle, Louis Hamelin, Dany Laferrière, Robert Lalonde, Monique Proulx, Simon Roy, Gaétan Soucy et Lise Tremblay. Ces livres seront mis en vente en août et en septembre.
Ces initiatives seront le point d’orgue d’une année riche en événements. En effet, à la suite du changement à la direction générale, qui a vu Gilles Ostiguy et Renaud Roussel prendre la relève de Pascal Assathiany, le Boréal a quitté la rue Saint-Denis pour s’installer aux Entrepôts Dominion. Situés en plein cœur de Saint-Henri, le quartier emblématique du Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy, les nouveaux bureaux accueillent depuis mai l’équipe de la maison. Catherine Ostiguy, en plus de ses fonctions de directrice littéraire jeunesse, épaule désormais Jean Bernier, directeur éditorial, à titre d’éditrice à temps plein.
Du haut de ses soixante ans, le Boréal demeure une maison d’édition indépendante dont la mission est de maintenir vivante la littérature d’hier tout en contribuant à façonner la littérature de demain.
Renseignements :
Gabrielle Cauchy, attachée de presse, 514 336-3941 poste 229, gabrielle.cauchy@dimedia.com
Cérémonie de remise du Prix des cinq continents de L’OIF à Monique Proulx
22 mars 2023

Discours de Monique Proulx
Madame la Secrétaire générale, chers membres du jury qui m’avez fait l’honneur de choisir mon livre parmi des œuvres fortes de partout, chers vous tous qui maintenez vivante une organisation vouée à la célébration de la francophonie, mes amis, francophones ou francophiles
Je veux d’abord féliciter chaleureusement Yahia Belaskri pour son roman Le Silence des Dieux, qui s’est mérité une mention spéciale du jury.
En tant que Québécoise, je suis heureuse de ce prix plus que de n’importe quel autre. Il me semble que c’est l’une des choses que le Québec a fait de mieux jusqu’à maintenant, garder la tête du français hors de l’eau et l’inciter à nager loin avec grâce et opiniâtreté, en dépit de la houle et des vents contraires.
« Pourquoi écrivez-vous en français? » m’avait demandé il y a quelques années le journal Libération, et j’en avais été offusquée, puisque dans notre partie du monde nous sommes tombés dans la potion gauloise dès le XVIIe siècle, et qu’aussi bien me demander: pourquoi respirez-vous par le nez?
Mais il est vrai que, depuis, beaucoup parmi nous, Québécois, sommes maintenant des bâtards, des bâtards mâtinés de sang irlandais et amérindien qui s’est mêlé sans coaguler avec le sang des vieux Poitou et Charente, pour maintenant recevoir une transfusion de globules des cinq continents justement, et voici ce que ça donne, voici comment ça sonne.
Bien entendu, notre position stratégique en Amérique nous fait recevoir sans cesse des invitations à nous exprimer dans la langue universelle, speak white please, mais nous les refusons sans politesse et tenons ferme notre bout et notre os, et nous mordons quand il le faut – et il le faut souvent.
On pourrait se demander: pourquoi tant de ténacité? Pourquoi ne pas glisser dans l’osmose anglophone, puisque l’essence de l’humanité est sans doute de communiquer avec ses semblables, peu importe la courroie de transmission?
Il semble que ce n’est pas possible. Il semble que l’identité de l’humanité, à tort ou à raison, s’obstine à s’incarner dans sa langue – ou sa religion, mais c’est une autre histoire. Je m’émerveille de penser que dans des déserts où ondulent les dunes de sable, la même langue chante que dans nos champs où s’accumulent les bancs de neige. Mais je ne peux oublier que si dans nos champs le français fut langue de la résistance, elle fut peut-être dans les déserts langue de l’envahisseur.
S’il faut aimer sa langue, il ne faut pas se définir uniquement par elle.
Les écrivains, d’ailleurs, sont écrivains avant d’écrire, sont écrivains presque de naissance, dans leur regard et leur interprétation du monde, et ensuite ils utilisent la glaise à leur portée – qu’elle soit l’italien, l’espagnol, le français, l’arabe, l’inuktitut – pour sculpter leurs univers.
Je ne dirai jamais que le français est la seule langue dans laquelle j’aurais pu écrire.
Mais je dirai certainement que le français a porté tant de musiques puissantes, a été porté par tant d’écrivains grandioses, qu’il est un trésor universel, un héritage somptueux qu’aucun de ses descendants de gré ou de force n’a le luxe de perdre.
Je dirai qu’écrire en français, c’est jouer d’un instrument sophistiqué qui murmure autant qu’il tonitrue, qui batifole et qui assassine, aussi apte aux palabres qu’aux confidences, dont jamais je ne verrai les limites, dont jamais je ne serai la virtuose totale que je rêve d’être.
Je dirai qu’écrire en français, c’est avoir accès à la beauté. À la beauté sonore qui se fraie un chemin depuis les profondeurs et remonte agiter la surface, agiter le lecteur, avant de replonger, le lecteur avec elle, dans le silence fertile où elle est née.
Monique Proulx
Mars 2023
Monique Proulx lauréate du Prix des cinq continents 2022

| Montréal, le 20 janvier 2023. C’est avec une immense joie que nous apprenons que le Prix des cinq continents de la francophonie 2022 a été attribué ce matin à Monique Proulx pour son roman Enlève la nuit, paru aux Éditions du Boréal. Créé en 2001 par l’OIF, le Prix des cinq continents récompense chaque année un texte de fiction narratif (roman, récit et recueil de nouvelles) original. Doté d’un montant de 15 000 euros pour le lauréat et de 5 000 euros pour la mention spéciale du jury, il met en lumière des talents littéraires reflétant l’expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents. L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) assurera ensuite sa promotion sur la scène littéraire internationale durant une année entière. La remise du Prix se fera durant le mois de mars 2023, en marge de la Journée internationale de la Francophonie. Détails sur le site de l’Organisation internationale de la francophonie |
Le Boréal se réorganise
Lundi 21 novembre 2022.
À l’approche de leur soixantième anniversaire, les Éditions du Boréal se réorganisent et mettent en place une nouvelle structure qui leur permettra de continuer à publier et à diffuser les auteurs et autrices québécois et canadiens.
S’appuyant sur des conseillers et conseillères littéraires aguerris ainsi que sur une équipe interne dévouée, la maison sera désormais dirigée par deux codirecteurs généraux : Gilles Ostiguy, jusqu’à présent directeur général adjoint, et Renaud Roussel, qui était directeur éditorial adjoint. Jean Bernier demeure directeur de l’édition ainsi que partenaire dans l’entreprise. Il sera épaulé par Catherine Ostiguy, qui deviendra éditrice à temps plein au printemps 2023.
L’actionnariat évolue également et les actions de Pascal Assathiany, qui demeure président du conseil d’administration, sont reprises par Gilles et Catherine Ostiguy, Renaud Roussel et Roger Gariépy.
Ainsi, le Boréal, tout en changeant, demeure une maison de littérature générale indépendante ayant à cœur la pérennité de sa mission éditoriale.
Symbole de cette évolution, le Boréal déménagera, au printemps 2023, vers les Entrepôts Dominion, sis à Saint-Henri, quartier historique où rayonne encore l’aura de Gabrielle Roy.
Pascal Assathiany, directeur général sortant, s’est dit « ravi de cette transmission qui mélange expérience et rajeunissement et qui permettra au Boréal de continuer à se développer et à occuper un espace majeur dans l’édition québécoise ».
Renseignements :
Gabrielle Cauchy, attachée de presse
514 336-3941 poste 229
Décès de Lori Saint-Martin

22 octobre 2022
C’est avec consternation et un immense chagrin que nous avons appris ce matin que Lori Saint-Martin est décédée subitement, à Paris. La triste nouvelle est confirmée, mais nous ne disposons pas de plus amples informations pour le moment.
Lori Saint-Martin tenait une position unique à la frontière des cultures anglophone et francophone, de l’université et de la littérature. Née à Kitchener, en Ontario, elle a fait carrière surtout en français, à Montréal, après avoir connu à l’adolescence un véritable coup de foudre pour cette langue. Écrivaine, elle a fait paraître plusieurs romans et recueils de nouvelles. Elle a signé plus de cent traductions, avec son mari, Paul Gagné, qui leur ont valu une renommée internationale et de nombreux prix, dont quatre Prix littéraires du Gouverneur général. Elle faisait encore paraître récemment un récit autobiographique, Pour qui je me prends, racontant son étonnant parcours, ainsi qu’un essai en hommage à la traduction littéraire, Un bien nécessaire.
Elle a également eu une importante activité d’enseignement. Ses recherches portaient surtout sur les questions féministes en littérature. Elle était membre et coordonnatrice de la recherche à l’Institut de recherches et d’études féministes de l’UQAM. Elle était en outre une spécialiste de Gabrielle Roy.
Lori Saint-Martin était membre de la société royale du Canada et venait d’être admise à l’Académie des lettres du Québec.
Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
Décès de Simon Roy

Montréal, le 18 octobre 2022
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Simon Roy ce samedi 15 octobre en après-midi. Celui-ci a demandé l’aide médicale à mourir après avoir courageusement lutté contre un terrible cancer au cerveau. Simon Roy a fait une entrée fracassante en littérature avec Ma vie rouge Kubrick, paru en 2014 aux Éditions du Boréal, dans la collection « Liberté grande » que dirige Robert Lévesque. Lauréat du Prix des libraires l’année suivante, ce livre contenait déjà tous les thèmes qui allaient hanter l’œuvre du romancier. S’appuyant sur une analyse obsessionnelle du film The Shining, de Stanley Kubrick, Simon Roy proposait une poignante interrogation sur la possibilité de continuer à vivre quand notre héritage familial est marqué par la tragédie. De manière plus caractéristique encore, il venait brouiller la frontière entre réalité et fiction pour créer une atmosphère aussi envoûtante que troublante. Simon Roy allait poursuivre cette réflexion sur la vérité et le mensonge dans les œuvres qui ont suivi : Owen Hopkins, Esquire (2016), Fait par un autre (2021), ahurissante biographie fictive d’un véridique faussaire, et Ma fin du monde (2022), où il évoquait de façon vertigineuse sa propre mort, qu’il voyait approcher, en tentant de lui opposer tous les sortilèges de la fiction.
Simon Roy a également connu une longue carrière de professeur de littérature au Cégep Lionel-Groulx, partageant sa passion pour les livres avec de nombreux étudiants qui mènent aujourd’hui des carrières d’écrivains ou qui œuvrent dans le domaine de l’édition.
Il laisse dans le deuil sa compagne, Marianne Marquis-Gravel, et ses enfants, Romane et Colin.
Il ne fait aucun doute que l’œuvre qu’il nous laisse, marquée par une profonde originalité, nous aura obligés à reconnaître que les récits, mêlant inextricablement réalité et mensonge, constituent la substance même de nos vies. En questionnant radicalement les prérogatives de la littérature, il nous aura rappelé son inépuisable pouvoir.
La Prière de l’épinette noire : un livre posthume de Serge Bouchard en librairie le 15 novembre

Montréal, le 6 septembre 2022. Le 15 novembre prochain paraîtra un livre posthume de Serge Bouchard intitulé La Prière de l’épinette noire. Il s’agit d’un recueil de textes brefs lus à l’émission radiophonique hebdomadaire C’est fou…, diffusée à ICI Première. Jean-Philippe Pleau, qui animait l’émission avec Serge Bouchard, en signe la préface.
Ce recueil fait suite à L’Allume-cigarette de la Chrysler noire et à Un café avec Marie, aussi publiés dans la collection « Papiers collés » des Éditions du Boréal. On y retrouve la même sensibilité poétique et la même sagesse moqueuse qui caractérisent la prose de Serge Bouchard, autour de thèmes qui l’ont toujours inspiré : la nature, la solidarité humaine, l’amitié avec les Autochtones, les bizarreries du monde actuel, la beauté, la mélancolie.
L’épinette noire, gloire de la préhistoire, est une antenne qui nous relie à l’éternité. Elle nous insuffle une sagesse morose, une mélancolie du long cours. C’est l’arbre sur lequel je m’appuie, là où je repose mon esprit, mon dos brisé, mes jambes mortes. L’arbre sous lequel je bois ma tasse de thé, résolu, fatigué, heureux devant le petit feu qui sent si bon.
Anthropologue passionné par l’histoire et par le savoir autochtone, homme de radio, écrivain et essayiste de premier plan, Serge Bouchard (1947-2021) a fait paraître une quinzaine de livres aux Éditions du Boréal, notamment la série des « Lieux communs », coécrite avec Bernard Arcand, et des recueils de textes brefs, entre autres Les corneilles ne sont pas les épouses des corbeaux (2005), C’était au temps des mammouths laineux (2012), Les Yeux tristes de mon camion (2017), L’Allume-cigarette de la Chrysler noire (2019) et Un café avec Marie (2021). Ses livres lui ont valu l’attachement d’un vaste public et d’importantes distinctions, dont le prix Gérard-Morisset du gouvernement du Québec et le Prix littéraire du Gouverneur général du Canada.
– 30 –
Renseignements :
Gabrielle Cauchy, attachée de presse
514 336-3941 poste 229
Gabrielle.cauchy@dimedia.com
René Lévesque, en toute liberté !
À quelques jours du centenaire de sa naissance, les Éditions du Boréal sont heureuses de dévoiler au grand public une facette méconnue de René Lévesque, soit celle de chroniqueur de cinéma. La maison publiera le 1er novembre Lumières vives, qui réunira 88 chroniques de cinéma signées par René Lévesque, parues dans Le Clairon de Saint-Hyacinthe entre 1947 et 1949.
Avec une liberté totale et une impeccable érudition, le jeune critique de 25 ans y aborde autant les classiques du cinéma que la production commerciale d’ici et d’ailleurs. Abusant sans vergogne d’un franc-parler dont il a dû se défaire en entrant à Radio-Canada puis en politique, René Lévesque se révèle un éblouissant styliste. Il y parle des comédiens d’une façon extraordinaire et rare.
S’il s’enflamme quand il veut partager ses enthousiasmes (pour Rome, ville ouverte ou Le Diable boiteux, par exemple) ou quand il parle de ses réalisateurs de prédilection (Ford, Lubitsch, Hitchcock), s’il déploie une inattendue sensibilité en dressant de passionnants parallèles entre l’art d’un Jouvet, d’un Fresnay ou d’un Barrault, il sait se montrer d’une réjouissante méchanceté quand il s’agit de dénoncer les travers d’un art qui prend trop souvent l’aspect d’une industrie.
Ces textes offrent un portrait unique de la vie culturelle dans le Québec de l’après-guerre, période dite de la Grande Noirceur.
C’est à Jean-Pierre Sirois-Trahan, professeur de cinéma à l’Université Laval, que nous devons la redécouverte de ces chroniques. C’est lui qui a établi la présente édition et qui en signe la présentation.
En librairie le 1er novembre 2022
- « Page précédente
- Page 2 de 109
- Page suivante »
Tél: (514) 287-7401 Téléc: (514) 287-7664
Les photos des auteurs ne peuvent être reproduites sans l'autorisation des Éditions du Boréal.